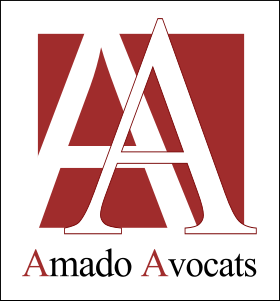08 Juil Droit du travail – juillet 2025
Rupture du contrat de travail – Maladie professionnelle.
Cass., Soc., 25 juin 2025, n° 23-22821.
Source
L’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.
L’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle :
– qui oppose le salarié et la Caisse devant la juridiction de sécurité sociale ;
– ne tend pas aux mêmes fins qu’une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant le salarié à l’employeur devant la juridiction prud’homale.
Rupture du contrat de travail – Discrimination en raison de l’état de santé.
Cass., Soc., 25 juin 2025, n° 23-17999.
Source
Selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nulle.
Selon l’article L. 1231-1 du même code, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Il résulte de ces textes que le salarié dont la rupture de la période d’essai est nulle pour motif discriminatoire :
– ne peut prétendre à l’indemnité prévue en cas de licenciement nul ;
– mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture.
L’article 1er de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 énonce que celle-ci :
– a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ;
– en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ;
– et n’est donc pas applicable en cas de discrimination en raison de l’état de santé.
Décompte de la durée du travail – Justificatifs.
Cass., Soc. 25 juin 2025, n° 23-20007.
Source
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail :
– lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif ;
– l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié :
– de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies ;
– afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement :
– sans être tenu de préciser le détail de son calcul ;
– l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Rupture du contrat de travail – Validité de la convention de rupture.
Cass., Soc., 25 juin 2025, n°24-12096.
Source
Selon l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Aux termes de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci :
– notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
– qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
Selon l’article L. 1237-14 du code du travail, la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions :
– qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture ;
– l’employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle ;
– pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période.
Toutefois, la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture :
– naît dès l’homologation de la convention, le licenciement n’affectant pas la validité de la rupture conventionnelle ;
– mais ayant seulement pour effet, s’il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d’effet prévue par les parties dans la convention.
Chauffeurs de VTC – Lien de subordination.
Cass., Com. 25 juin 2025, n° 23-22430.
Source
Constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur.
Il en résulte que le fait pour un concurrent de s’affranchir des obligations imposées par la législation du travail peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale.
Il résulte de l’article L. 3120-2, III, 1° du code des transports :
– qu’il est interdit aux chauffeurs de VTC et aux centrales de réservation auxquelles ils ont recours :
– d’informer un client, avant une réservation préalable, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique.
Lorsque le client est informé, avant réservation :
– à la fois de la localisation et de la disponibilité de tous les véhicules situés sur la voie ouverte à la circulation publique les plus proches du lieu où il se trouve ;
– ce texte n’exige pas qu’il puisse sélectionner de façon spécifique l’un d’entre eux.
Il résulte de l’article L. 8221-6 du code du travail :
– que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère ;
– sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie :
– lorsque ces personnes fournissent des prestations ;
– dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir :
– de donner des ordres et des directives ;
– d’en contrôler l’exécution ;
– et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination :
– le travail au sein d’un service organisé ;
– lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Exécution du contrat de travail – Attribution d’actions gratuites.
Cass., Soc., 18 juin 2025, n° 23-19748.
Source
Selon l’article L. 225-197-1 du code de commerce (rédaction issue loi n° 2015-990 du 6 août 2015 en vigueur du 8 août 2015 au 24 mai 2019) applicable au litige, l’attribution d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux des sociétés par actions, intervient dans le cadre d’un plan qui doit définir :
– d’une part, une période d’acquisition des droits, d’une durée d’un an au minimum, au terme de laquelle le bénéficiaire devient propriétaire des actions ;
– d’autre part, une période de conservation, d’une durée minimum de deux ans en principe, pendant laquelle le bénéficiaire ne peut pas vendre les actions, même s’il en est propriétaire.
Il résulte de ces dispositions :
– d’une part, que le bénéficiaire n’acquiert définitivement les actions attribuées qu’à l’issue d’une période d’acquisition et sous réserve de remplir les conditions librement fixées par le plan d’attribution d’actions gratuites ;
– d’autre part, que la distribution d’actions gratuite aux salariés, qui a pour objet de les fidéliser ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières ;
– ne constitue pas la contrepartie d’un travail et n’a donc pas la nature juridique d’un élément de rémunération.
Ensuite, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur :
– notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise ;
– tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il en résulte que le salarié :
– qui n’a pu, du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu avant le terme de la période d’acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites ;
– ne peut revendiquer aucune indemnisation pour la perte de chance d’avoir pu les acquérir, sauf à démontrer une fraude de l’employeur dans le recours à l’article L. 1224-1 du code du travail.
Rupture du contrat de travail – Données à caractère personnel.
Cass., Soc., 18 juin 2025, n° 23-19022.
Source
Aux termes du point (1) de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par « données à caractère personnel » toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») :
– est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée ;
– directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant ;
– tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Selon l’article 15, §§ 3 et 4, du RGPD relatif au « Droit d’accès de la personne concernée », la personne concernée a le droit :
– d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées ;
– et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel.
Le responsable du traitement :
– fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement ;
– sous réserve que le droit d’obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.
Il en résulte :
– d’une part, que les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD ;
– et, d’autre part, que le salarié a le droit d’accéder à ces courriels, l’employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires…) que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui.
Règlementation du travail – Obligation de sécurité.
Cass., Soc. 11 juin 2025, n°24-13083.
Source
Aux termes de l’article L. 4623-3 du code du travail (rédaction loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur :
– des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail ;
– justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Aux termes de l’article L. 4624-6 du code du travail (rédaction loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4.
En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’employeur :
– tenu d’une obligation de sécurité, doit en assurer l’effectivité, en prenant en considération :
– les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ;
– justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-3 du code du travail.
Exécution du contrat de travail.
Cass., Soc., 11 juin 2025, n° 24-15297.
Source
Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail :
– lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié ;
– il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :
– soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 ;
– soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;
– soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Elections professionnelles – Composition du collège électoral.
Cass., Soc., 4 juin 2025, n°24-16515.
Source
Selon l’article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral :
– les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes ;
– correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Selon l’article L. 2314-32 du même code :
– la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 ;
– entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
La règle de l’alternance n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa de l’article L. 2314-30.
Il en résulte que le respect de la règle de l’alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.